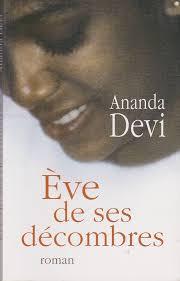
Quelque part, dans l’œil du vertige,
22 décembre 2025
Cher Maïga,
plus la caféine grimpe dans ma tête, plus je descends aisément en moi, je suis un oiseau déployant ses ailes dans son propre gosier, les nuages pissent des canons d’encre sur ma tête, j’ouvre mes lèvres à la glissade d’une goutte, c’est d’abord le goût de ma cervelle qui s’agrippe à ma langue, elle suinte sur la page que je farcie avec l’empressement de quelqu’un qui s’ensépulture à la vue de sa fin, une fois dans sa cachette, il lève la tête et voit le cœur de la mort qui bat en souriant, il comprend qu’il a pris la cage thoracique de sa fin pour une tour sépulcrale d'invisibilité; un couvercle taillé à la chevelure des ombres de la parole se lève sur mes décombres, la vraie lumière jaillit toujours des entailles que les ordures intérieures laissent sur la rétine de la conscience dans l'affrontement entre elles et nos yeux qui refusent de les voir, je bois, je descends, je tourbillonne, ce n'est pas un tango verbal, je suis un verre de nescafé qui se remue au petit matin pour contempler sa mousse, je me mire sur les joues blanches de la mousse, la mousse contemple sa beauté au fond de mes yeux, se dresse sur le pont invisible de nos regards troqués, le goût du texte, je suis dans la clairière du roman, la saveur du récit vient se nicher au bout de ma langue, il fait jour en moi : elle commence par ce nom : Ananda Devi, comme « Ananas délice » ; en vérité, je te le dis, ami : la succulence du récit saisit avec la majesté d'un jus qu'on sert rarement sur la table littéraire ; roman polyphonique, porté par de jeunes voix, des cordes vocales qui n'ont pas encore connu le câlin du temps, mais qui sont vieilles du poids de ce qu’elles portent ( je doute qu'un humain puisse connaître son âge vrai, c'est-à-dire un âge à l'image de son vécu, « Je me sens vieille, [ dit Ève] » (p.108) : qu'est-ce qui fait vieillir à dix-sept ans ?; « J'ai vécu plusieurs vies. Et encore d'autres dont je ne me souviens pas. » (p.110), quel âge a-t-on lorsque certaines de nos vies ont tourné le dos à la mémoire de la vie présente ? autant chercher l'acte de naissance du ciel), quatre jeunes voix qui charrient des débris de vies traînantes à Troumaron, nous sommes sur l'île Maurice, et sur cette île, d'autres îles existentielles, des solitudes, des personnages d'une froideur étonnante parfois, Ève, sa mère, et cette nonchalance dit tout de leur condition, deux filles et deux garçons de la même école : les filles : Ève et Savita, « deux mains d'un même corps » qui « peuvent faire ce qu'elles veulent, quand elles veulent », « nul besoin de garçon dans leur sourire », la première est mince certes, mais possède un territoire intérieur éclairé par un feu qui décongèle les désirs, un territoire que tous rêvent d'habiter, et dont elle ouvre facilement les portes huileuses, elle donne son corps à qui le veut comme on pose sa blouse sur les épaules d'un touriste grelottant de froid sur un rond-point au cœur d'une ville sans issue, et même violentée dans sa générosité horizontale, elle dit qu'« un corps, ça se répare »; toutefois, elle garde l'essentiel, ce qu'il y a au-delà de la chair —elle donne sans se donner, on pourrait parler d’une « écriture du corps » à la marge de l’âme ; la fragilité (feinte ?) de l’héroïne est un piège, le corps ici est une armure d’insoumission, une arme de résistance qu’elle donne à ses bourreaux pour qu’ils se crucifient, dès lors, dans le même geste, elle reprend le pouvoir en le donnant —en offrant un semblant de pouvoir aux mâles qui ne voient pas au-delà de la dune de leur désir—, son indifférence hante son entourage comme un démon dévorant les ovules dans les entrailles d’une femme gabonaise qu’une main de pasteur ne tardera pas à extirper, Alléluia !; derrière l’armure se tient la Ève véritable, profonde, elle semble habiter les décombres d'un territoire dont elle est l'unique déesse, elle ne pleure ni ne rit de sa vie : elle observe la vie autour d'elle, elle sait qu'elle n'est pas aussi faible qu'on le croit, se lit dans son regard absent cette pensée de Fatou Diome : « L’entrejambe d’une femme : l’alpha et l’oméga de l’homme »; la deuxième, Savita, son amie, le second poumon de l’être qu’elles forment toutes les deux, l'aime, elle s'inquiète pour elle, elle veut la comprendre et peut-être l'amener à changer, mais Ève « veut posséder son temps, ses actes, ses décisions, son corps » (p.127) ; le corps de Savita est retrouvé dans une poubelle, mais c'est Ève qui est morte « Depuis que j'ai été autopsiée sur la table, [ dit-elle ] je ne me vois plus que comme un cadavre sous son regard baveux. En réalité, je suis morte. En réalité, j'ai disparu sous le linceul. » (p.109), c'est dans la mort de son amie que Ève semble ressuscitée : « L'année de mes dix-sept ans. Tout m'est arrivé : la vie et la mort » (p.110) ; c'est après son assassinat (Savita) que tout bascule pour chacun, un basculement synonyme de redressement, d'étranglement de l'ombre par la lumière, sauf qu'encore cette lumière a le corps couvert du sang de l'ombre, et donc, est une autre ombre ; la mort accouche-t-elle d'une vie ? oui, peut-être, mais quelle lumière habite la vie que la mort insuffle à une existence ? les garçons : Sad et Clélio, le premier est un disciple de Rimbaud, en tout cas, il se le dit, les murs de sa chambre sont fleuris de vers en l'honneur (mot ronflé et ronflant, donc dégoûtant) d'Ève qu'il aime à la folie, « le jour où je dirai je t'aime à un homme, [lui dit Ève], je me suiciderai » (p.47); aimer c’est perdre la tête, Sad, enfin, pour avoir son « je t’aime », veut couvrir ses mains d'un sang qu'il n'a pas versé : « Je lui dis, c’est bien, ils seront obligés de libérer Clélio, et puis, ça me donnera une excuse. Une excuse ? Quand j’irai me rendre à la police. Elle secoue la tête et m’explique, patiente : Non, c’est moi qui l’ai tué, pas toi. Ève, dis-je, laisse-moi faire […]. Je ne veux pas que tu te fasses accuser à ma place, dit-elle. Je t’interdis de le faire. Je n’ai pas besoin de toi […]. Je regarde les dégâts sur son corps. Elle a été sculptée comme une roche basaltique. Je ne comprends rien à la violence ; elle est là, partout. Un poison suspendu dans l’air. Mais j’ai au moins une certitude : pour elle, avec elle, pour une saison ou plusieurs, je suis prêt à aller en enfer. » (pp.154-155); voilà ce que signifie aimer : aller en enfer pour l’autre ; le deuxième, Clélio, a « assez de colère pour remplir dix fois le panier percé de [sa] vie » —la métaphore est juste : tous ses enfants ont une vie de panier percé ( comment remplit-on un panier qui ne porte pas de caleçon ? tu es beaucoup plus intelligent que moi, ami; répond), il est en guerre, il se bat « contre tous et personne », un jour, c'est sûr, et il le sait, il tuera quelqu'un : ses parents peut-être, ou un employeur ou un copain de la bande ou une femme ou lui-même; la rage en fermentation dans le poing, il revendique sa part d'odeur de vin divin pour apaiser la vague de frustration, de déception et d'inquiétude qui déploie ses ailes dans les blessures qu'a laissées le départ de son frère aîné allé en France, des blessures que pimentent les promesses non tenues de son aventurier de frère; Clélio veut en découdre avec le monde entier, « des gamins qui mordent, oui ; mais derrière eux, il y a des loups qui attendent de faire surface et de déchiqueter » (p.142) ; nous le comprenons avec l'arrestation de Clélio : « quand les gens se regardent, avant de voir un visage, ils voient une étiquette qui y est attachée à vie » (p.143); c’est dans l’obscurité carcérale que son esprit s’éclaire sur lui-même et sur la vie : « On dirait que je deviens un saint, en prison. Je commence à comprendre tout le monde. Je cesse de penser à moi. » (p.118) ; Clélio, au fond de sa cellule où l’esprit ou le fantôme de son Carlo de frère s’invite dans ses rêves, souhaite une seconde chance « Si quelqu’un m’écoute, j’aimerais bien une seconde chance. Quitte à me faire prêtre. », il veut « couper les liens avec le passé [pour ne pas qu’il le] tire en arrière » (p.117), il veut partir à sa propre rencontre, mais l’étiquette de violence qu’on lui colle désormais, ―qu’il a forgée lui-même―, se présente comme sa véritable prison ; le début du récit est à un pas de la fin de l’histoire, ça commence in medias res : « Marcher m’est difficile […] Je marche, même si je voudrais courir vers moi-même. La nuit vibre. La ville tremble. Je suis sortie. Rien ne m’arrêtera plus. » (pp.9-10), la véritable place de ce passage dans l’histoire est entre les pages 150 et 151 ―as-tu remarqué l’absence du nom « Ève » à ce niveau ?―, juste avant un « chapitre » de ce que tu appelais « journal intime » incorporé dans le récit, qui n'en est pas un : il s'agit plutôt, je crois, d'un monologue intérieur analeptique à la deuxième personne du singulier (je t'épargnerai le jargon des universitaires littéraires, promis) : « L’oubli est le trait d’union entre jour et nuit, la paroi lisse qui te protège de toi-même. Tu deviens sourde. Tu n’entends plus les grondements qui jadis tourmentaient tes oreilles. Tu n’entends plus la musique, trop contradictoire, par rapport à ton regard. » (p.32), Ève, main armée par l’inspecteur de police, en face du meurtrier de son amie (qui n’est pas Clélio) : « Tu le regardes et tu es sidérée par le changement qui a eu lieu en lui. » (p.151), tu comprends le sens du tour analeptique ? elle écrit bien, Ananda, avec des mots ciselés, avec une poésie qui force l'admiration, et elle est concise, et elle sait cajoler le flou, et elle est profonde; lorsque tu m'as parlé, l'autre jour, de masochisme, du plaisir de la douleur, connaissant ton goût pour les métaphores lubriques à la Sami Tchak, toi, un peulh sanctifié au lait, qui préfères traquer les fantômes des livres plutôt que la joie de la chaleureuse compagnie des bœufs, j'ai compris que le récit, dans ta tête peuplée d'images de femmes claires que tu n'auras jamais, est un peu comme une griffith où la victime grimpe au rideau avant le/la coupable (les deux se font maintenant ou depuis toujours dans la cité nôtre, remarque); le lecteur est sans doute choqué, mais il y a un plaisir à tirer de ce choc car, nolens volens, quelque part en lui, quelque chose sait que même le chaos a une vertu : « c'était choquant, certes, mais c'était bien », murmure-t-il à la fin; de fait, Ève se fait grimper naïvement ou volontiers —les deux se confondent— par son professeur chaque soir après les cours et la bonne petite brindille desséchée ne dit rien, elle ne vit rien, les choses la traversent comme un oiseau traverse le vent sans que ce dernier ne se demande pourquoi il est traversé ou n'en ressente un quelconque déchirement dans sa chair, il sait seulement que le vol est la quiddité même de l'oiseau ( Ève a du sang meursaulien ), ou, si l'on veut, c'est un texte-braise sur lequel on pose le pied un matin de froid sans nescafé, la brûlure vient quelques secondes après qu'on a retiré le pied : le livre fermé, quelque chose d'indicible bouge dans un coin de l'esprit, on dirait une pendule accrochée à l'entrée d'un univers sans ciel pour servir de cachette aux anges, en cognant les parois de l'âme, le son qui nous fait un clin d'oreille au fond de la gorge de ce tic-tac est celui-là : retirer le couteau planté dans le sexe de l’Enfance ou crever dans nos décombres, ― qui a dit que l’école n’est pas le premier lieu de la prédation sexuelle ? où sont les parents, pas les géniteurs, les parents ? « J’avais douze ans (…) Un crayon. Une gomme. Une règle. Je tendais la main parce que, dans mon cartable, il n’y avait rien. J’allais à l’école, vide de tout. J’éprouvais une sorte de fierté à ne pas posséder. On pouvait être riche de ses riens (…) les garçons un peu plus grands me protégeaient. Ils me donnaient ce que je voulais (…). Et puis, un jour, quand j’ai demandé comme d’habitude sans en avoir l’air, on m’a demandé quelque chose en retour (..). Dans mon cartable, il y avait le vide : de l’appartement, plus petit et plus nu que tous les autres, de nos armoires, et même de notre poubelle. Il y avait l’œil de mon père, que l’alcool rendait graisseux. Il y avait la bouche et les paupières scellées de ma mère. Je n’avais rien, rien du tout à donner. Mais je me trompais. Ce qu’il voulait, c’était un bout de moi. »― ,une fois cette voix sonore bue avec sa mousse en dégonflement, une vérité crue, cruellement belle, nous appelle de la main : un texte réussi célèbre l'incertitude de sa compréhension, l'impossibilité, presque, même pour l'auteur, de mettre sa quintessence dans un verre de lecture qu'on boirait sans qu'aucune goutte signifiante n’échappe à la bouche épaisse de notre esprit, l'œuvre littéraire réussie effraie le critique ( je n'en suis pas encore un — je m'amuse à donner des couleurs à mon ennui, tout simplement— la précision est importante : sur la plage numérique, tout le monde est connaisseur, sachant de quelque chose , on a même des coachs en développement littéraire incapables de faire tenir sur ses pieds une métaphore qui ne soit pas souillée d’abominations littéraires de lycéens incultes, et des écrivains professionnels, ma foi ! sans aucune consistance littéraire, lapant leur morve sans honte en disant « hey, vous voyez, c'est sucré ( ce qui est faux, la morve est salée, j’en ai goûté à l’enfance), je suis fort », —Seigneur, ne leur pardonne pas, ils savent ce qu'ils font—, dans un tel monde donc, il n'y a que des cons comme moi, et peut-être toi aussi, puisque tu veux me suivre dans mes hérésies, qui sont sûrs de ne rien savoir, de n'être rien, n’oublie pas de mettre tout ceci sur le compte de ma prétention, bénie soit la connerie !), le met face à la fragilité de ses certitudes littéraires, le roman réussi est une Ève : il donne mais ne se donne pas, et pourtant, chaque lecteur y trouve sa part de jouissance; je respire, je respire, ami, et chaque souffle est un bâillement de l'urgence, et pourtant, il faut que je ferme la gueule du chien qui aboie dans ma tête, d'autres vertiges attendent mon coup de fouet; en fin de compte, « l’homme [est-il notre destin et notre mort » ? (p.125), oui, peut-être ; merci, ami, merci pour la passe décisive à la Neymar, je promets de t'enterrer dignement dans le ventre d'une virgule si jamais tu crèves, ainsi renaitras-tu l’écrivain de ton rêve.
Issouf Coulibaly,
Critique littéraire








